Pathologie Traumatique
La pathologie traumatique de la moelle épinière est la cause la plus fréquente des lésions médullaires, nettement plus fréquente que la pathologie tumorale, infectieuse ou démyélinisante.Son incidence varie entre 2,5 et 57,8 cas par million d’habitants et par an et, les accidents de la voie publique en représentent la première cause.
Les traumatismes médullaires touchent essentiellement les adultes jeunes, de sexe masculin (sex-ratio = 4/1), avec un pic de fréquence entre 20 et 35 ans.
Bien que la moelle épinière soit une structure bien protégée, les traumatismes peuvent engendrer des lésions médullaires isolées ou associées à un traumatisme du canal osseux. L’atteinte médullaire ou radiculaire se rencontre dans environ 20% des traumatismes rachidiens.
Son coût social est élevé : beaucoup de patients gardent une paraplégie ou une tétraplégie irréversible.
Les traumatismes médullo-rachidiens intéressent, chez l'adulte, essentiellement le rachis cervical en particulier les niveaux C4, C5 et C6 ainsi que la charnière cervico-dorsale C7-T1. En cas d'atteinte du rachis dorsal, la vertèbre T12 est la plus souvent atteinte.
Chez l'enfant, ils concernent les trois premières vertèbres cervicales et la charnière cervico-occipitale.
I) Clinique
A) Phase initiale
Le choc spinal et le choc neurogénique sont les deux principaux tableaux observés au stade aigu d'un traumatisme médullaire.Le choc spinal est un état physiologique transitoire de dépression réflexe des fonctions médullaires sous le niveau lésionnel avec, perte de toutes les fonctions sensitivo-motrices.
Cliniquement, une hypertension artérielle puis une phase d'hypotension sont observées. Une paralysie flasque est observée et est parfois associée à un priapisme.
Ces symptômes disparaissent en quelques heures à quelques jours lorsque les arcs réflexes sous-lésionnels sont à nouveau fonctionnels [140].
Le choc neurogénique se manifeste par une triade clinique : hypotension, bradycardie et hypothermie. Il survient en cas de lésion haute au-dessus de T6 par l'interruption des voies réflexes sympathiques. Les lésions osseuses et/ou ligamentaires associées aux lésions médullaires peuvent aggraver le pronostic fonctionnel [141].
B) Tableaux lésionnels médullaires
Quelques heures à quelques jours après la phase de choc spinal ou neurogénique, la symptomatologie va laisser place à différents tableaux lésionnels selon la topographie et l’extension de la lésion traumatique de la moelle épinière.On distingue ainsi le syndrome médullaire complet, le syndrome médullaire antérieur, le syndrome centro-médullaire et le syndrome de Brown-Sequard [142] :
- Une tétraplégie ou une paraplégie ainsi qu’une anesthésie complète témoignent d’une section de la moelle épinière située respectivement au niveau cervical ou thoracique (au-dessus de C4, il existe également une paralysie respiratoire).
- Une atteinte de la motricité volontaire aux quatre membres prédominant aux membres inférieurs, avec respect de la proprioception, oriente vers un syndrome médullaire antérieur assez limité.
- Une atteinte centro-médullaire est évoquée devant, un déficit moteur prédominant aux membres supérieurs, associé à une anesthésie thermo-algique avec une sensibilité tactile et proprioceptive épargnées.
- Un syndrome de Brown-Sequard reflète l’atteinte unilatérale d’une hémi-moelle et comprend : une paralysie homolatérale à la lésion, avec hyper-réflexie et signe de Babinski positif ; une abolition de la sensibilité thermo-algique controlatérale (la limite supérieure de cette anesthésie se situe 2 à 3 segments en dessous de la lésion) ; une atteinte homolatérale des sensibilités proprioceptives.
C) Atteinte radiculaire
Une atteinte radiculaire suggère une lésion du trou de conjugaison. Elle s’accompagne d’une douleur projetée dans le dermatome de la racine lésée.En cervico-thoracique, les niveaux radiculaires et vertébraux coïncident ; en lombaire, les racines de la queue de cheval émergent en revanche à des niveaux variables par rapport aux pédicules et aux disques.
La paralysie musculaire oriente également vers le niveau radiculaire atteint [143] :
- L’atteinte de C3 à C5 s’accompagne d’une paralysie diaphragmatique.
- Les atteintes de C5 et C6 touchent le deltoïde, le biceps, le brachial antérieur et le long supinateur.
- L’atteinte de C7 ressemble à une paralysie radiale épargnant le long supinateur.
- Les atteintes de C8 et T1 touchent la musculature de la main.
- Les lésions de L4, L5 et S1 s’accompagnent respectivement d’une paralysie du jambier antérieur, des péroniers latéraux et des muscles de la loge postérieure de la jambe.
II) Technique IRM
L’imagerie par résonance magnétique est l’examen de choix dans l’étude des lésions médullaires et permet également la visualisation directe et optimale des lésions radiculaires, péri-médullaires et disco-ligamentaires.L'IRM aide aussi à dater les lésions hémorragiques (aiguë, subaiguë, chronique).
L'exploration médullaire complète est effectuée en 20 à 30 minutes.
A) Indications
Elle est indiquée chez le traumatisé rachidien qui présente une symptomatologie médullaire ou radiculaire ; cette indication est d’autant plus évidente si les examens radiographiques et TDM sont normaux chez un patient présentant un déficit neurologique.Les principales indications de l’IRM dans les traumatismes vertébro-médullaire incluent [144] [145] :
- Une radiographie ou une TDM suggérant une lésion ligamentaire (hématome, spondylolisthésis, élargissement d’un disque ou d’un espace inter-épineux).
- Recherche d’un hématome épidural ou une hernie discale avant une tentative de réduction.
- Recherche d’une lésion médullaire chez les patients présentant des signes neurologiques.
- Exclure des lésions ligamentaires ou osseuses chez des patients présentant une discordance radio-clinique.
- Déterminer la stabilité d’une atteinte cervicale.
- Différencier une atteinte hémorragique ou non de la moelle spinal (les lésions hémorragiques étant de moins bon pronostic).
B) Installation du patient
Le bilan en imagerie, en IRM en particulier, est réalisé [146] :- Après restauration et stabilisation des paramètres vitaux en salle d’urgence avec, si nécessaire, monitorage des paramètres vitaux et assistance ventilatoire utilisant du matériel compatible avec l’IRM.
- Après bilan neurologique complet par un spécialiste.
- Avec la prudence la plus stricte lors de la prise en charge du traumatisé : manipulations respectant l’alignement tête-nuque-tronc, en évitant toute traction et toute déviation dans le plan frontal ou sagittal.
- En veillant à l’immobilité complète du patient (sédation possible en cas d’agitation).
- En éliminant tout matériel de contention (colliers ou minerves) éloignant de l’antenne le territoire à investiguer et, représentant une source potentielle d’artéfacts.
- En dehors de toute contre-indication à l’IRM.
C) Séquences IRM
L’examen IRM doit combiner des coupes sagittales sur toute la longueur de la moelle et des coupes axiales « ciblées » sur le territoire anormal.Les coupes sagittales et axiales pondérées en T1 ES renseignent sur les lésions osseuses, l’atteinte de l’espace épidural et des espaces sous-arachnoïdiens.
Les coupes sagittales et axiales pondérées en T2 TSE/FSE, associées à des coupes sagittales en T2 STIR, permettent la recherche d’œdèmes et ; de lésions osseuses, discales et ligamentaires [147].
Les images en EG, pondérées en T2*, renseignent sur les espaces sous-arachnoïdiens et sur la présence d’éventuelles hémorragies au sein ou autour de la moelle. En outre, elles réduisent les artéfacts de flux (meilleure définition du sac dural) et, précisent les éventuels traits de fracture ainsi que la présence de fragments osseux ou discaux au sein du canal [148].
L'injection de gadolinium est rarement nécessaire au stade aigu en raison de l'absence de rupture de barrière hémato-médullaire.
D’autres techniques comme la diffusion et, de nouvelles techniques comme l'imagerie du tenseur de diffusion ont montré une utilité potentielle dans l'évaluation diagnostique des lésions médullaires.
Les séquences de diffusion pourraient montrer des anomalies qui n'ont pas été vues sur les séquences classiques. [149] [150]
L'imagerie du tenseur de diffusion est une application de la diffusion qui permet de visualiser les fibres de substance blanche normales ou leurs perturbations dans le cadre de la pathologie.
Des recherches récentes ont suggéré que l'imagerie du tenseur de diffusion peut montrer des lésions plus étendues par rapport à ce qui a été mis en évidence sur les séquences conventionnelles [151].
D) Place de l’IRM dans la décision thérapeutique
Face à un tableau radiologique de luxation vertébrale la préférence du chirurgien diffère selon les écoles entre une réduction rapide (censée donner le plus de chance de récupération neurologique) et une réduction différée, après un bilan IRM pour dépister d’éventuelles lésions intra-canalaires qui pourraient compliquer la réduction (fragment discal notamment) [152].L’indication d’une réduction chirurgicale d’urgence est posée sur la base de l’évolution de la symptomatologie, sur le délai entre le traumatisme et la prise en charge, ainsi que sur la persistance éventuelle de signes de compression médullaire en IRM.
Le chirurgien attend du radiologue la précision de la topographie et de la nature de l’élément compressif qui sont déterminantes dans le choix de l’abord.
Le bilan IRM initial doit également fournir des éléments pronostiques quant à l’évolution de la lésion médullaire (récupération ou non, lésion hémorragique ou non), et ce d’autant plus que l’état général du patient limite l’évaluation clinique.
III) Aspects lésionnels
A) Lésions intra-médullaires
1) Étiopathogénie des lésions intra-médullaires
La lésion traumatique de la moelle épinière peut résulter d’une élongation, d’une compression mécanique directe « persistante » (par un débord discal, un hématome, un fragment osseux en cas de fracture, ou par la translation associée à une luxation) ou « transitoire » (bombement ligamentaire en hyperextension), ou d’une atteinte vasculaire secondaire, surtout si les artères perforantes terminales sont touchées.Ces atteintes sont à l’origine de phénomènes hémorragiques et d’œdème de sévérité variable qui peuvent s’étendre longitudinalement.
Dans certains cas, on peut parfois observer des lésions médullaires sans atteinte osseuse ni ligamentaire.
Ces lésions sont appelées SCIWORA (spinal cord injury without radiological abnormality).
Chez l’enfant, ces lésions sont attribuées au volume important de la tête, à la laxité ligamentaire et à la mobilité du segment cervical immature.
Chez l’adulte, cette variante reste rare, grave et difficile à prendre en charge. L’étroitesse canalaire et les remaniements dégénératifs (ostéophytes) jouent un rôle crucial dans les SCIWORA chez l’adulte [153].
2) Aspects à l’IRM
L’IRM est le seul examen qui fournit une évaluation objective de l'architecture interne de la moelle spinale.Typiquement, au niveau du segment atteint, la moelle a une morphologie fusiforme avec une hémorragie centrale et un œdème péri-lésionnel plus important.
Le degré de déficit neurologique est directement lié à la sévérité des anomalies à l’IRM.
Les principales lésions qui peuvent être retrouvées en IRM sont :
- L’élargissement du cordon médullaire qui est bien visible en coupe sagittale.
- L'œdème médullaire se traduit par une plage en hypersignal, qui peut être très étendu dans le plan sagittal.
- L'hématome ou l’hémorragie intra-médullaire.
- Dans les cas extrêmes, on peut observer des lésions de transsection médullaire.
a. Hémorragie intra-médullaire
L'hémorragie intra-médullaire siège généralement au niveau de la substance grise centrale et leur localisation permet une détermination plus précise du niveau de l’atteinte neurologique.Dans la phase aiguë, la désoxyhémoglobine prédomine et apparaît en hyposignal sur les séquences pondérées en T2, d’autant plus net en T2*. En pondération T1, l’hémorragie apparait en iso-signal voire, en léger hypersignal.
La désoxyhémoglobine peut évoluer en méthémoglobine après environ 8 jours. L’hémorragie se manifeste alors par hypersignal T1 et T2 [154].
Étant donné que les techniques d'IRM avancées actuelles ont une sensibilité et une résolution spatiale accrues, de minuscules foyers d'hémorragie peuvent être détectés.
Une hémorragie importante, de plus de 10 mm de longueur, indique souvent une lésion neurologique complète, en particulier si elle est située dans la région cervicale.
On note aussi qu’une atteinte hémorragique de moins de 4 mm était de bon pronostic [15].
Une hémorragie franche implique un mauvais pronostic et le siège de l'hémorragie correspond au niveau neurologique de la lésion [16].
La compression résiduelle de la moelle par des fragments osseux, un disque ou un liquide est prédictive d'une hémorragie intra-médullaire et, par conséquent, un facteur de mauvaise récupération neurologique [157].
b. Œdème
L’hémorragie intra-médullaire est toujours associée à un œdème de la moelle.
Cependant, l’œdème peut survenir isolément, comme dans le cas d’une contusion de la moelle épinière (
L’œdème correspond à une lésion post-traumatique avec accumulation de liquide intracellulaire et interstitiel. Il est détecté par un hypersignal T2 associé à un iso- ou hyposignal T1 [158].Figure 47
,Figure 48
).Une tuméfaction du cordon médullaire est souvent associée. L'œdème peut s’étendre de l'équivalent d'un tiers de la hauteur d'un corps vertébral toutes les 8 heures.
En outre, la longueur de l'œdème de la moelle spinale est directement proportionnelle au degré de déficit neurologique initial [159].
Sans hémorragie, l'œdème médullaire, seul, implique un pronostic plus favorable.
c. Transsection médullaire (Figure 49)
Il s'agit d'une blessure rare observée dans les cas d’hyperflexion associée à une distraction extrême (par exemple lors d’un choc frontal en voiture avec décélération brutale) et de blessure pénétrante.
Dans les blessures pénétrantes, il est possible que le cordon soit considérablement endommagé avec peu de lésions osseuses évidentes. Dans ces cas, la lésion de la moelle est soit due à une déchirure directe, soit secondaire à une blessure par explosion causée par des mécanismes à grande vitesse tels que des coups de feu.
d. Pronostic
Les résultats de l'IRM dans les lésions médullaires montrent une étroite corrélation avec le déficit neurologique initial.Les données de l'IRM médullaire ont une valeur pronostique très importante concernant la récupération neurologique [160].
Les critères de mauvais pronostic comprennent : un œdème étendu sagittalement, la présence et l’étendue de plages hémorragiques intra-médullaires, ainsi que la présence d’une compression persistante par un hématome épidural [17].
Ces éléments annoncent une récupération incomplète voire, l’absence de récupération.[161]
L’IRM peut être normale au stade aigu : on parle alors de commotion médullaire, de bon pronostic si la clinique s’avère rassurante.
Il a toutefois été rapporté un manque de sensibilité de l’IRM conventionnelle au stade aigu chez des sujets déficitaires ; le pronostic fonctionnel est alors très réservé chez ces patients pour lesquels une IRM en séquence de diffusion pourrait s’avérer plus informative.
Par ailleurs, l’IRM ne permet pas de différencier les lésions médullaires primaires des lésions préexistantes. Dans ces cas, l’IRM de diffusion avec calcul de l’ADC est indiquée.
e. Lésions séquellaires (Figure 50, Figure 51)
Des plages d’hyposignal marqué lié à la présence d’hémosidérine peuvent être observées à l’emplacement d’anciens foyers hémorragiques.
Certains patients peuvent présenter, plusieurs mois à plusieurs années après le traumatisme, une nouvelle détérioration neurologique connue sous le nom de myélopathie post-traumatique qui comprend [162] :
- Des formes cavitaires représentées par la syringomyélie (formées par la fusion de petites plages liquidiennes), qui apparaît comme une plage bien délimitée en iso-signal par rapport au LCR ; en hyposignal T1 et hypersignal T2.
- Des formes non cavitaires représentées par la myélomalacie, qui se manifeste par un léger hyposignal T1, un hypersignal T2 et des limites floues.
B) Lésions intra-canalaires extra-médullaires
1) Hématomes
L'IRM permet également de distinguer les deux types d'hématomes péri-médullaires, épiduraux et sous-duraux, plus rarement rencontrés.Ces deux hématomes extra-médullaires peuvent être à l'origine d'une compression médullaire qui se traduit par une disparition complète des espaces péri-médullaires avec un refoulement vers l'avant, vers l'arrière ou latéralement du cordon médullaire [148].
Lors d’une suspicion d’hématome épidural ou sous dural, l’IRM médullaire est indiquée en urgence. Elle permet ainsi de confirmer la nature hémorragique, de différencier l’hématome épidural et sous-dural, de localiser l’hématome et préciser son étendu, d’évaluer le retentissement de l’hématome et de détecter des lésions sous-jacentes. L'hématome épidural est le plus souvent d’origine traumatique. Il peut aussi être spontané ou secondaire à : une hypertension artérielle, des troubles de l’hémostase, un traitement anticoagulant, une exceptionnelle malformation vasculaire. L'hématome sous dural peut être dû à un traumatisme, une prise d'anticoagulants, une ponction lombaire ou une rachianesthésie [163].
a. Hématome épidural (Figure 52, Figure 53)
L'hématome épidural s'étend en hauteur le plus souvent sur plus de 5 vertèbres.
En coupe axiale, il a une forme de lentille biconvexe. L'hématome épidural est séparé de la moelle par l'hyposignal T2 de la dure-mère qui apparaît décollé.
Ses extrémités supérieure et inférieure sont effilées. La graisse de l'espace épidural est effacée ou amputée : c’est le signe principal qui permet de différencier la localisation épidurale de la sous-dural [164].
Dans le cadre d’un hématome épidural, on retrouve une collection en [165] :
- Un iso (aigu) ou hypersignal T1 (subaigu) dans l'espace épidural.
- Hypersignal T2 hétérogène.
- Hyposignal en T2*.
- Après injection de Gadolinium, l’hématome ne se rehausse pas. Cependant, un rehaussement de la pie-mère est possible.
On recherche aussi :
- Un refoulement des espaces liquidiens péri-médullaires.
- Un hypersignal T2 intra-médullaire en regard, témoignant d’une souffrance médullaire associée.
- Au stade hyper-aigu (6 premières heures), l'hématome apparaît en iso-signal T1 par rapport à la moelle épinière et, légèrement hyperintense et hétérogène sur les images pondérées en T2.
- Au stade aigu (7 à 72 heures), l'hématome est encore iso-intense en pondération T1. Mais, devient en hyposignal en pondération T2. Cela est dû à la présence de désoxyhémoglobine intracellulaire, qui provoque un raccourcissement de T2.
- Au stade subaigu, l'hématome devient en hypersignal homogène sur les images pondérées en T1 et T2 [166].
b. Hématome sous-dural
L'hématome sous dural, d'aspect lobulé, se présente comme une masse ou une coulée intra-canalaire.Le plus souvent, il siège au niveau thoracique ou thoraco-lombaire. Sur le plan antéro-postérieur, il est surtout antérieur.
Il est souvent moins étendu en hauteur que l'hématome épidural.
Il se présente forme de croissant en coupe axiale, en dedans de l'hyposignal T2 de la dure-mère. La graisse épidurale est respectée sans infiltration.
L’hématome sous-dural peut comprimer la moelle et entraîner une discrète déformation du cordon médullaire à très grand rayon de courbure [167].
2) Racines
L’avulsion des racines nerveuses et de leur gaine lors d’un traumatisme survient typiquement au niveau de la charnière cervico-thoracique par traction sur le plexus brachial.L’IRM en coupes fines recherche la désinsertion de radicelles.
Plus tard, une ou plusieurs collections liquidiennes, appendues au sac dural, au niveau d’émergences radiculaires arrachées (pseudo-méningocèles post-traumatiques) peuvent être visibles. Cependant, la racine avulsée, elle, n’est pas visualisée [168].
La collection liquidienne se manifeste sous forme d’une expansion hyper-intense en pondération T2, appendue au sac dural ; dont elle est séparée par la dure-mère. Elle est volontiers plus intense que le LCR normal.
×
![]()
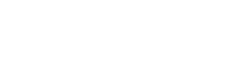
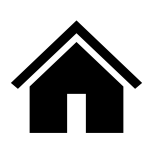 Accueil
Accueil Bibliographie
Bibliographie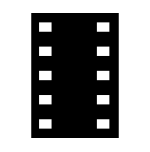 Galerie d'images
Galerie d'images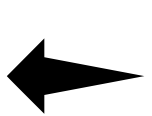 Précédent
Précédent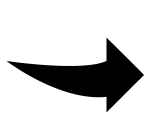 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.