Pathologie Malformative Vasculaire
Le terme de malformations vasculaires médullaires recouvre plusieurs entités. Leur classification intègre les notions de structures anatomiques concernées par la malformation et les notions d’angio-architecture permettant de comprendre leur retentissement.On distingue trois grands types de malformations vasculaires :
- Les malformations nourries par les artères spinales : malformations artério-veineuses (dites intra-médullaires), fistules péri-médullaires.
- Les malformations nourries par des branches méningées : fistules durales à drainage veineux péri-médullaire.
- Les malformations vasculaires complexes : syndrome de Cobb et malformations intra- et péri-médullaires.
I) Clinique
Les malformations vasculaires médullaires sont caractérisées par leur rareté et la non-spécificité de leur symptomatologie. Elles peuvent, selon le type concerné, avoir un mode de révélation aigu (paraplégie brutale en rapport ou non avec un saignement) ou présenter une symptomatologie progressive sur plusieurs semaines ou plusieurs mois [193].II) Imagerie
L’IRM joue un rôle essentiel dans le diagnostic de la malformation, qui repose sur la mise en évidence de vaisseaux anormaux dans la moelle ou ses enveloppes. Les progrès des séquences d’angiographie par résonance magnétique (ARM), notamment en acquisition dynamique, en font un examen de référence pour confirmer le type de la malformation et pour assurer le contrôle évolutif des patients.A) IRM
C’est l’examen de première intention devant toute pathologie médullaire. L’exploration classique comporte des séquences sagittales pondérées en T1 et en T2 complétées par des coupes axiales pondérées en T2. L’injection de gadolinium n’est pas systématique.Les vaisseaux dilatés dans la moelle ou dans les espaces sous-arachnoïdiens ont une image serpigineuse « vide de signal », à contours nets, mieux détectée en T2*. Ces images ne doivent pas être confondues avec les images de flux du LCR dans les espaces sous-arachnoïdiens. Des coupes sagittales et coronales en T2 3D en haute résolution (comme la séquence FIESTA ou SPACE) démontrent les structures vasculaires dilatées avec une grande précision et permettent de confirmer le diagnostic, lorsque que les séquences T2 restent douteuses. [194]
Les vaisseaux à flux lent se rehaussent après injection IV de gadolinium. Ce rehaussement souligne souvent la périphérie de la moelle par rehaussement des plexus de localisation piale.
Parfois, il peut être délicat de différencier les vaisseaux normaux des vaisseaux dilatés dans le cadre d’une malformation vasculaire.
L’IRM permet également d’analyser les répercussions de la lésion sur le parenchyme médullaire.
En effet, les anomalies vasculaires peuvent s’accompagner d’une anomalie médullaire comme une anomalie morphologique avec élargissement ; ou des signes indirects de myélopathie liée à un œdème, une hémorragie, voire une ischémie.
La visualisation d’une éventuelle ischémie nécessite la réalisation de séquences de diffusion en complément des séquences conventionnelles.
Après injection de gadolinium, on observe un rehaussement tardif de la moelle épinière dans tous les cas ; dans un tiers des cas, le rehaussement est précoce.
B) ARM
D’un point de vue général, l’imagerie est rendue délicate en raison des différentes caractéristiques propres à la moelle épinière et à ses enveloppes : faible diamètre du canal vertébral, artéfacts de flux du LCR, artéfact de l’aorte.Les artères spinales, même dilatées dans le cas d’une pathologie vasculaire, sont extrêmement fines et sinueuses, rendant l’analyse du signal complexe.
Les techniques d’ARM utilisées au niveau de l’encéphale comme le 3D-TOF (« time of flight », temps de vol en contraste de phase 3D) ne sont pas efficaces et seule l’angiographie dynamique après injection de gadolinium est recommandée.
III) Classification
Les fistules et malformations artério-veineuses médullaires sont représentées, selon Kim et Spetzler, en 2006 [195] par :- Les fistules artério-veineuses extra-durales (ou fistules épidurales), correspondant à une communication anormale entre une branche d’une artère radiculaire et des veines épidurales.
- Les fistules artério-veineuses intra-durales dorsales (ou fistules durales), correspondent à une communication anormale entre une artère radiculaire au niveau de la gaine radiculaire et les veines péri-médullaires. L’augmentation de pression au sein des veines péri-médullaires conduit à un œdème centro-médullaire et une myélopathie.
- Les fistules artério-veineuses intra-durales ventrales (ou fistules péri-médullaires), siègent au niveau de l’espace sous-arachnoïdien, au niveau du sillon médian ventral de la moelle ; le shunt se fait entre une artère spinale antérieure et des veines péri-médullaires.
- Les malformations artério-veineuses intra-médullaires possèdent des afférences uniques ou multiples provenant des artères spinales antérieures et postérieures.
- Les malformations artério-veineuses extra-intra-durales qui correspondent à des lésions métamériques, qui touchent simultanément la peau, les structures osseuses et musculaires, la moelle épinière et les racines nerveuses ; c’est le syndrome de Cobb.
- Les malformations artério-veineuses du cône médullaire représentant une catégorie particulière, du fait, d’une part, d’afférences multiples à partir des artères spinales antérieures et postérieures et, d’autre part, de shunts artério-veineux directs avec des veines efférentes très dilatées. Cela se traduit par des lésions ischémiques, notamment des cornes antérieures, et d’une compression du cône médullaire et des racines de la queue de cheval.
IV) Malformations artério-veineuses (MAV) intra-médullaires
Anciennement appelées malformations vasculaires de type 2, ce sont des malformations congénitales, même si leur architecture se modifie secondairement. Elles représentent 10 à 15% des malformations vasculaires médullaires.Elles sont toujours constituées par des shunts artério-veineux de petite taille, multiples, réalisant une structure complexe appelée nidus.
Ce nidus peut être compact ou diffus, et siège le plus souvent au niveau thoraco-lombaire. Il est situé dans la profondeur de la moelle ou, à la fois en intra-médullaire et à la surface de la moelle.
C’est une malformation à haut débit, alimentée par l’artère spinale antérieure et une ou plusieurs artères spinales postérieures.
Le drainage s’effectue par des veines médullaires dilatées à flux rapide.
A) Clinique
C’est une pathologie de l’adulte jeune (20 ans en moyenne) avec nette prédominance masculine.La symptomatologie est le plus souvent brutale, due à la survenue d’une hématomyélie (épanchement sanguin au sein de la substance grise médullaire) ou d’une hémorragie méningée spinale.
L’hématomyélie se traduit par une para- ou une tétraplégie brutale, associée à des douleurs rachidiennes. Le niveau du déficit correspond en règle à la localisation de la MAV, car l’hématome est centré sur le nidus. La résorption secondaire de l’hématome s’accompagne d’une régression spontanée partielle des symptômes.
La symptomatologie initiale est parfois subaiguë, due à une ischémie secondaire à l’hémo-détournement.
B) IRM (
Figure 66
)- Un nidus, qui correspond à une zone médullaire en vide de signal en pondération T2, et surtout en écho de gradient pondéré en T2*. En pondération T1, le nidus apparait en hyper- ou hyposignal selon l'orientation de ces vaisseaux.
- Une tuméfaction de la moelle épinière au niveau du nidus, apparaissant ainsi en hypersignal en pondération T2.
- Des images serpigineuses « vide de signal » en T1, T2, STIR et T2*, traduisant la présence de vaisseaux anormaux à flux rapide.
V) MAV du cône médullaire
D’abord décrite pat Hurst et al. en 1999, la classification de Spetzler et al. a inclus les MAV du cône médullaire dans une catégorie à part.Elle est caractérisée par plusieurs artères afférentes, des nidi multiples et un réseau veineux efférent complexe.
Ces lésions ont de multiples shunts artério-veineux et siègent, habituellement, au niveau dural extra-médullaire mais, une composante intra-médullaire peut aussi être associée. La localisation des lésions est spécifique : au niveau du cône médullaire et de la queue de cheval. Cependant, elles peuvent connaitre une extension tout au long du filum terminal.
La symptomatologie se manifeste par une hyperpression veineuse, des signes de compression du cône médullaire ou une hématomyélie. Contrairement aux autres lésions artério-veineuses spinales, les MAV du cône médullaire se manifestent souvent par l’association d’une myélopathie à une radiculopathie.
VI) Fistules péri-médullaires
Elles sont aussi appelées fistules artério-veineuses intra-durales ventrales, ou anciennement, malformation vasculaire de type 4.Ce sont également des malformations congénitales, mais elles sont plus rares que les MAV et, sont constituées par un shunt entre une artère spinale antérieure et une veine péri-médullaire. Elles siègent le plus souvent sur le cône médullaire ou les racines de la queue de cheval mais, elles peuvent être sur n’importe quel segment de la moelle.
Selon Spetzler et al. [197], on reconnaît trois types de fistules en fonction du volume du shunt, qui conditionne l’aspect de l’imagerie et la symptomatologie clinique :
- Le type A est un micro-shunt à flux lent entre une artère spinale antérieure grêle et une veine péri-médullaire ascendante à flux lent. La localisation intéresse uniquement le cône médullaire ou le filum terminal.
- Le type B, également localisé au niveau du cône médullaire et du filum terminal, est le plus fréquent, constitué de multiples pédicules artériels dilatés et de plusieurs shunts de petit calibre.
- Le type C est rare, de topographie cervicale ou thoracique. C’est une malformation à flux rapide avec un large shunt et d’énormes ectasies veineuses.
A) Clinique
La symptomatologie est relativement similaire à celle des MAV, mais les patients présentent souvent une myélopathie progressive du cône médullaire. L’irradiation douloureuse radiculaire est également plus fréquente. Le polymorphisme clinique traduit la diversité des types de fistules et leurs complications : hypertension veineuse, compression médullaire (lors de gros shunts) et hémo-détrournement.B) IRM
Classiquement, l’IRM montre des images serpigineuses, autour de la moelle spinale, « vide de signal » en T1, T2, STIR et T2*. Cependant, contrairement aux MAV, on n’observe pas de nidus.Dans le shunt de type A, du fait de la trop petite taille de la malformation, l’IRM peut être normale. Un hypersignal centro-médullaire du cône terminal en pondération T2 témoigne de l’hypertension veineuse [198]
. En cas de shunt important, l’IRM retrouve des images vasculaires péri-médullaires et des ectasies veineuses, apparaissant en hyposignal sur les séquences pondérées en T1 et T2, qui peuvent comprimer la moelle [199].
VII) Fistules durales artério-veineuses
Aussi appelées fibules artério-veineuses intra-durales dorsales, fibules artério-veineuses durales à drainage veineux péri-médullaire, ou anciennement, malformation vasculaire de type 1, la fistule artério-veineuse durale représente la malformation vasculaire médullaire la plus fréquente. [200]La fistule durale est une fistule à flux lent. Elle est le plus souvent unique, constituée d’un shunt entre une branche méningée d’une artère radiculaire et une veine qui se draine anormalement par voie rétrograde vers les veines péri-médullaires. Les fistules sont surtout de topographie thoraco-lombo-sacrée. Le shunt est extra-médullaire, situé dans l’épaisseur de la dure-mère en regard d’un pédicule [201]
. Le radiologue est souvent le premier à évoquer le diagnostic sur la base des anomalies retrouvées sur les IRM médullaires.
A) Clinique
La présentation clinique est totalement différente de celle des MAV. La tranche d’âge est plus élevée et la symptomatologie généralement progressive. Elles surviennent préférentiellement chez un homme d’environ 60 ans, se manifestant de façon progressive par des troubles moteurs, sensitifs et génito-sphinctériens, traduisant la myélopathie ascendante secondaire à l’hyperpression veineuse médullaire.Son diagnostic est souvent porté tardivement avec une morbidité importante si absence de traitement [202].
B) IRM (
Figure 67
). À cette zone en hypersignal T2 correspond parfois une même zone en hyposignal T1. À l’injection de gadolinium, on observe une prise de contraste de type « patchy » (en mottes).
Lorsqu’elle est réalisée, l’imagerie de diffusion note un coefficient apparent de diffusion élevé, témoignant d’un œdème vasogénique, en principe réversible [203]
. La visualisation des images vasculaires péri-médullaires anormales n’est pas constante en raison de leur flux très lent sur les séquences T1 et T2 conventionnelles. Lorsque les anomalies sont détectées, elles se manifestent par une dilatation veineuse péri-médullaire avec un aspect serpigineux. Elles prédominent à la partie postérieure de la moelle et, sont bien visibles sur les séquences en écho de gradient T2 (T2*) sous la forme d’un vide de signal. Leur absence ne permet pas d’éliminer formellement le diagnostic [196].
Une séquence ARM dynamique injectée à large « field of view » (FOV) permet également de visualiser les dilatations vasculaires et orienter vers l’étage du shunt artério-veineux tout en objectivant la localisation de l’artère d’Adamkiewicz [204]. Il est toutefois à noter que la visualisation d’une dilatation des veines péri-médullaires peut parfois manquer et que la seule visualisation d’un œdème médullaire étendu doit faire réaliser une artériographie médullaire en l’absence d’étiologie évidente.
VIII) Malformations artério-veineuses complexes
A) Syndrome de Cobb
C’est une malformation vasculaire congénitale, métamérique ou pluri-métamérique, avec anomalie vasculaire plus ou moins marquée de la peau (angiome capillaire ou angiome plan), des muscles, des vertèbres et de la moelle épinière.L’imagerie permet de reconnaître les éventuelles localisations angiomateuses : para-vertébrale, vertébrale de type artério-veineux, épidurale et méningée, intra-médullaire [205].
B) Autres malformations complexes
Les syndromes de Klippel-Trenaunay et de Parkes-Weber, associent des malformations vasculaires des membres inférieurs qui se traduisent par des malformations cutanées capillaires, des varicosités veineuses et une hypertrophie d’un membre inférieur [206].La maladie de Rendu-Osler-Weber (télangiectasie hémorragique héréditaire), caractérisée par une télangiectasie polyviscérale, peut présenter une localisation médullaire unique, mais cela demeure exceptionnelle.
IX) Malformations vasculaires épidurales
Ces anomalies sont très rares. C’est un groupe hétérogène et mal classifié d’affections aux dénominations variées (angiome caverneux épidural, angiome veineux épidural, varices épidurales, télangiectasies épidurales, malformation artério-veineuse épidurale). Elles sont exceptionnellement responsables d’un hématome épidural, de radiculopathies ou d’une myélopathie d’installation progressive due à l’hypertension veineuse médullaire [207].A) Malformations capillaro-veineuses épidurales
Moins de 50 cas ont été rapportés dans la littérature. Elles apparaissent comme des masses épidurales, surtout de siège lombosacré, plus rarement thoracique, exceptionnellement cervical.L’aspect des images à l’IRM est celui d’images nodulaires ou linéaires en hyposignal T1 et en hypersignal T2 avec un rehaussement en séquence pondérée T1, après injection de gadolinium [208].
B) Malformations ou fistules artério-veineuses épidurales et pararachidiennes avec drainage épidural
Ces malformations représentent une entité très rare. Le diagnostic différentiel est relativement difficile en raison de l’aspect à l’IRM, similaire à celui des fistules durales avec : la mise en évidence de structures sinueuses « vides de signal », représentant les veines intra-canalaires dilatées.
×
![]()
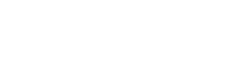
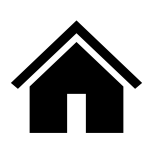 Accueil
Accueil Bibliographie
Bibliographie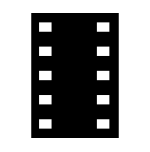 Galerie d'images
Galerie d'images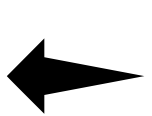 Précédent
Précédent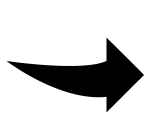 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.