Pathologie Infectieuse
I) Myelite infectieuse par atteinte directe
Dans ces myélites, l’agent infectieux entraîne une lésion directe de la moelle spinale. La symptomatologie associe une fièvre et des signes généraux non spécifiques. La fièvre peut être concomitante aux symptômes neurologiques ou se terminer avant leur apparition (un tiers des cas environ). La sémiologie médullaire est celle d’une myélite transverse aiguë, d’aggravation progressive sur 2 à 3 jours.[78]D’autres atteintes neurologiques comme la méningo-radiculite peuvent parfois être associées, ce qui est un élément différenciant des myélites auto-immunes qui sont souvent de localisation centrale uniquement.[79]
La topographie lésionnelle est principalement thoracique ou lombaire, à l’origine de troubles sphinctériens précoces.
Les germes à l’origine de ces myélites sont multiples et doivent être recherchés activement. Certains ont un pronostic particulièrement mauvais compte tenu de leur toxicité vasculaire comme c’est le cas avec le virus herpes simplex (HSV), le cytomégalovirus (CMV) ou le virus varicelle-zona (VZV).
L’interrogatoire permet d’orienter le diagnostic étiologique en fonction du terrain clinique.
L’IRM médullaire avec injection de produit de contraste est l’examen de choix à réaliser à l’admission du patient. Elle retrouve principalement une MATLE, qui n’est pas spécifique du mécanisme infectieux.
Une des spécificités des atteintes médullaires infectieuses est la fréquente association IRM à une fine prise de contraste leptoméningée (comprenant l’arachnoïde et la pie-mère) et à des prises de contraste radiculaires touchant en particulier la queue de cheval.
A) Atteintes d’origine virale
1) Herpès simplex virus (HSV)
a. Généralités
La myélite à HSV est rare mais de mauvais pronostic, elle laisse souvent d’importantes séquelles et peut parfois conduire au décès.Elle peut toucher le sujet immunodéprimé, l’enfant ou le sujet âgé immunocompétent.
L’analyse histopathologique des lésions a révélé de larges zones de nécrose contenant des antigènes viraux et une vascularite médullaire.
L’association à des lésions cutanées, en général dans un dermatome thoracique, ou à une encéphalite permet d’évoquer rapidement ce germe.
La symptomatologie est celle d’une myélite transverse avec, au premier plan, des dysesthésies des membres inférieurs, des paresthésies génitales et des troubles sphinctériens.
Cette myélite a la particularité de pouvoir récidiver de façon contemporaine aux éruptions cutanées dans l’HSV2 ; ce qui très rare dans l’HSV1.
b. Aspect à l’IRM médullaire
Classiquement, Une lésion peut apparaître comme une plage intra-médullaire en hypersignal T2, localisée au niveau latéral ou en postéro-latéral en regard de l’émergence radiculaire postérieure ou étendue au plus à une hémi-moelle.Généralement, la lésion s’étend en hauteur au maximum sur deux métamères.
La lésion peut se rehausser après injection de gadolinium. La cohérence entre le territoire des lésions cutanées avec le myélomère atteint confirme le diagnostic.
Par ailleurs, l’imagerie peut aussi être normale ou présenter les lésions correspondant à une MATLE.
2) Varicelle-zona virus (VZV)
C’est une affection très rare due, lors d’un zona, à la réactivation du virus qui s’étend du ganglion vers la racine sensitive postérieure et la moelle épinière.La myélite à VZV peut se voir chez les patient immunodéprimés, notamment lors de certains traitements par immunosuppresseurs (fingolimod, corticothérapie ou anti-TNFα). Elle peut également survenir chez les patients âgés immunocompétents [80].
a. Clinique
La myélite peut être contemporaine ou non du zona. Lorsque celui-ci survient, il est localisé le plus souvent au niveau thoracique et apparaît deux semaines avant la myélite.Les symptômes débutent du côté de la lésion cutanée par un déficit moteur aigu qui se complète le plus souvent en un tableau de myélite transverse en 1 à 3 semaines [81]. Le diagnostic doit être évoqué quand le métamère de l’éruption cutanée correspond au niveau de la lésion médullaire.
Cependant, la myélite peut se manifester par d’autres formes cliniques comme le syndrome de Brown-Sequard ou encore son association à une polyradiculonévrite. Plus rarement, elle évolue rapidement sur quelques heures, réalisant un tableau de vascularite nécrosante de pronostic catastrophique [82].
La myélite du VZV fait partie des myélites mortelles pour laquelle un traitement antiviral doit être instauré en extrême urgence.
b. Aspect à l’IRM médullaire
L’IRM est souvent anormale, réalisant un tableau de MATLE ou retrouvant une prise de contraste des racines en cas de polyradiculonévrite associée. La myélite peut prédominer au niveau des cordons postérieurs.On retrouve un hypersignal T2 médullaire asymétrique, postéro-latéral, en regard de la racine postérieure, plus ou moins étendu en avant et en controlatéral. En séquence T1 avec injection de gadolinium, on peut observer un rehaussement de la racine et de la lésion médullaire.
Exceptionnellement, le VZV peut se manifester par une méningo-myélite hémorragique, qui se traduit par une moelle tuméfiée en hypersignal en T2 avec des foyers hypo-intenses en T2* et une prise de contraste à l’injection de gadolinium.
3) Cytomégalovirus (CMV)
La myélite à CMV survient essentiellement chez les patients atteints par le VIH au stade SIDA mais, peut aussi survenir exceptionnellement chez les immunocompétents.La myélite s’aggrave sur plusieurs jours avec une symptomatologie de myélite transverse préservant souvent la proprioception. Dans la majorité des cas, l’atteinte neurologique est associée à d’autres manifestations cliniques comme la rétinite, l’atteinte digestive ou pulmonaire qu’il faut systématiquement rechercher [83].
L’IRM est normale dans 40 à 50 % des cas. Lorsqu’elle est pathologique, elle peut objectiver soit une MATLE, soit une prise de contraste des racines correspondant à une polyradiculomyélite. À noter que le CMV peut entraîner une myélopathie ischémique liée à une vascularite nécrosante de mauvais pronostic.
Classiquement, on observe des hyposignaux en T1 et des hypersignaux en T2. La localisation centro-médullaire des anomalies du signal serait en faveur de l’origine infectieuse, alors que les localisations postérieures et/ou latérales orienteraient vers une sclérose en plaques.
Dans les cas de polyradiculomyélite, l’IRM montre une tuméfaction de la queue de cheval avec un rehaussement leptoméningé et des racines dorsales à l’injection de gadolinium voire, un rehaussement diffus des nerfs de la queue de cheval et du cône médullaire.
B) Atteintes d’origine bactérienne
1) Syphilis
La syphilis est une infection bactérienne sexuellement transmissible. La manifestation médullaire aiguë de la syphilis est rare mais, caractéristique de la phase tertiaire de la maladie, lors de la diffusion par voie hématogène du Treponema Pallidum.Lors de cette phase, une myélite à prédominance lombosacrée peut être observée, associée ou non à une atteinte des artères spinales antérieures ou postérieures. Une pachyméningite (infiltration avec fibrose de la dure-mère) peut également orienter le diagnostic étiologique.
Cette complication est devenue exceptionnelle compte tenu de l’utilisation répandue de la pénicilline.
À la clinique, on distingue trois formes : la myélite aiguë transverse, la myélite avec atteinte des cordons latéraux de la moelle et le tabès (caractérisé par un syndrome cordonal postérieur) [84].
a. Aspect à l’IRM médullaire
À l’IRM, elle se présente sous la forme d’une myélite extensive, parfois elle peut être limitée en hauteur à moins de 3 métamères.L’atteinte médullaire se localise principalement au niveau de la moelle thoracique.
La myélite syphilitique peut se distinguer des autres myélites par deux signes caractéristiques :
- Le rehaussement en « gouttière de bougie » se traduit par une prise de contraste superficielle (directement sous la pie-mère), nodulaire, peu étendue. Cet aspect oriente vers une invasion, par la neurosyphilis, de la moelle spinale à partir de sa surface.
- Le « flip flop sign » se manifeste, en pondération T2, par un hypersignal de la partie centrale de moelle associé à un iso- ou hyposignal de la partie superficielle. À l’injection de gadolinium, en pondération T1, c’est la partie superficielle qui se rehausse tandis que la partie centrale ne se rehausse pas. L’aspect de la partie centrale de la moelle oriente vers une lésion ischémique réversible [85].
b. Diagnostic différentiel
Le diagnostic différentiel se pose principalement avec : la myélite transverse idiopathiques, l’ischémie médullaire, l’EMAD et les métastases intra-médullaires.2) Borréliose
La borréliose, aussi appelée maladie de Lyme, est une maladie émergente (non évoquée dans la littérature ancienne) et une zoonose bactérienne systémique causée par Borrelia Burgdorferi. Elle est véhiculée par morsure de tiques infectées.Au cours des dernières années, le nombre de maladies transmises par les tiques, dont les conséquences peuvent être graves, a augmenté. Le risque d’être mordu par des tiques est particulièrement présent au printemps et en automne [86].
L’atteinte neurologique, ou neuro-borréliose, est une des formes possibles de la maladie (environ 15% des cas), et dont la myélite aiguë constitue une manifestation rare (4 à 5% des cas de neuro-borréliose) mais non exceptionnelle [87].
La myélite survient majoritairement à la phase aiguë, lors de l’apparition de l’érythème migrant.
L’imagerie permet d’argumenter le diagnostic de myélite et d’indiquer une ponction lombaire. En cas de symptomatologie radiculaire isolée, elle exclut une étiologie compressive [88].
a. Clinique
La manifestation neurologique la plus commune au niveau rachidien est la radiculite. Devant une sciatique ou une névralgie cervico-brachiale sans étiologie compressive, le diagnostic de maladie de Lyme doit être évoqué [89].L’association radiculite et myélite est relativement rare.
La clinique des myélites aiguës de Lyme consiste en une MATLE souvent sévère cliniquement, confinant à la para- ou tétraparésie dans près de 75 % des cas, associée à un déficit sensitif et des troubles sphinctériens. Plus rarement, elle peut se limiter à une atteinte sphinctérienne ou cordonale postérieure [90].
Des lésions ischémiques médullaires peuvent être induites par une artérite infectieuse.
b. Aspect à l’IRM médullaire
Classiquement, l’atteinte médullaire est toujours de plus de 3 métamères. La localisation de la myélite est plus volontiers cervicale, thoracique haute ou cervico-thoracique.La lésion se présente comme une plage en hypersignal T2 avec possibilité d’un rehaussement en T1 après injection de gadolinium [91].
L’aspect IRM est très variable : il peut aussi bien être celui d’une myélite transverse, d’une myélite à prédominance postérieure, ou bien d’une myélite atteignant préférentiellement la substance grise [92].
Parfois, la myélite n’est pas visualisée à l’IRM et seule la prise de contraste leptoméningée associée aux données de la clinique permet de poser le diagnostic de myélite.
c. Diagnostic différentiel
La prise de contraste leptoméningée n’étant pas spécifique, la sclérose en plaques et toutes les myélites inflammatoires en cas de myélite isolée le constituent le diagnostic différentiel, ainsi que toutes les radiculo-myélites infectieuses (notamment à CMV chez le patient immunodéprimé).3) Tuberculose
La tuberculose touche près de 10 millions de personnes et fait plus de 1,5 million de morts par an dans le monde, particulièrement dans les pays en développement où elle est endémique. La forme clinique la plus fréquente est l’atteinte pulmonaire [93].L’atteinte du système nerveux central au cours de la tuberculose est rare (1 % des cas) et de mauvais pronostic. Il s’agit le plus souvent d’une méningite ou d’une atteinte médullaire par compression extrinsèque au cours d’une spondylodiscite. Cependant, ici, nous présenterons l’atteinte médullaire intrinsèque [94].
Elle est grave, de diagnostic difficile, nécessite un traitement prolongé et peut laisser des séquelles irréversibles.
Les symptômes neurologiques ne sont pas spécifiques de la tuberculose et comprennent : une paraparésie (voire tétraparésie), une paresthésie, un niveau sensitif et des troubles génito-sphinctériens [95].
Aspect à l’IRM médullaire (
Figure 37
,Figure 38
)La grande variabilité des aspects à l’IRM est liée à la complexité de l’atteinte médullaire.
La majorité des patients présentent une radiculo-myélite mais un myélite isolée n’est pas exceptionnelle dans les atteintes médullaires [96]. L’association d’une atteinte médullaire tuberculeuse à une syringomyélie est aussi possible.
La syringomyélie apparait à l’IRM sous forme d’une grande cavité intra-médullaire en hyposignal T1 après injection de produit de contraste. Ce signe est défini comme une syringo-hydromyélie parce que la syringomyélie (une cavité excentrique de la moelle épinière) ne peut être différenciée de l'hydromyélie (une cavité médullaire centrale) par l’imagerie [97].
Les lésions de myélite siègent principalement au niveau de la moelle thoracique, cervicale ou de la jonction cervico-thoracique.
L’atteinte se présente comme une MATLE s’étendant sur plus de 3 métamères et occupant plus des 2/3 transversaux de la moelle.
Généralement, à l’IRM, elles apparaissent en iso- ou hyposignal T1. En pondération T2 et T2 STIR, les lésions apparaissent en hypersignal.
À l’injection de gadolinium, les lésions se rehaussent de manière variable : diffus, nodulaire, en couronne [98].
II) Myélopathie liée à une compression médullaire infectieuse
Cette situation clinique se voit principalement avec les agents infectieux bactériens comme le bacille de Koch (BK) ou le Staphylococcus aureus, et parasitaires comme l’Echinococcus Granulosus.Les abcès compressifs ne sont qu’exceptionnellement de localisation intra-médullaire ou sous-durale, et sont généralement des extensions épidurales de lésions osseuses.
Le tableau clinique se développe souvent sur quelques jours avec de la fièvre et une raideur méningée.
En cas d’abcès épidural, dans la plupart des cas, une raideur rachidienne et des douleurs sont localisées au niveau de l’abcès.
La myélopathie évolue le plus souvent de façon chronique sur un mode progressif, mais celle-ci peut aussi évoluer sur le mode aigu ou subaigu, nécessitant un bilan d’imagerie par IRM de façon urgente.
A) Bactéries pyogéniques
Les premiers signes IRM de spondylodiscite aiguë à pyogènes (à l’instar du Staphylocoque) sont des modifications du signal médullaire et la destruction d'un seul plateau vertébral.L’atteinte de la moelle osseuse entraîne un hyposignal T1 ainsi qu'un hypersignal T2 et un rehaussement après injection de Gadolinium.
La discite concomitante entraîne une perte de hauteur de celui ainsi qu’un hypersignal T2 avec un rehaussement post-Gadolinium.
Ces résultats d'IRM peuvent être accentués en utilisant les séquences STIR et/ou T1 FATSAT injecté.
Les collections de liquide hyperintense T2 rehaussant le rebord dans le disque intervertébral, les tissus mous para-spinaux ou dans l'espace épidural, correspondent à la formation d’abcès.
B) Tuberculose (
Figure 39
)Elle se manifeste principalement par une spondylodiscite, ou mal de Pott, et une compression médullaire par contiguïté (abcès, granulomatose ou luxation).
En IRM, la tuberculose rachidienne se traduit d'abord par une ostéomyélite du corps vertébral, avec un hyposignal T1, un hypersignal T2/STIR et un rehaussement après injection de Gadolinium.
Le disque intervertébral peut être épargné en cas d'atteinte vertébrale unique.
L'ostéomyélite vertébrale peut également entraîner un effondrement du corps vertébral, entraînant une vertèbre plane ou une déformation par compression antérieure [99].
Le mal de Pott est fréquemment associé à des abcès.
La propagation sous-ligamentaire de l'infection apparaît sous la forme de changements inflammatoires ou de collections de liquide rehaussant le rebord dans la direction crânio-caudale entre la LAL et les marges antérieures des corps vertébraux et des disques intervertébraux.
Il est également plus fréquent d'avoir une destruction vertébrale sévère, un abcès épidural et un rehaussement méningé associés à une spondylodiscite tuberculeuse.
C) Hydatidose (
Figure 40
)L’atteinte rachidienne touche les corps vertébraux, avec le plus souvent, une localisation dorsale (80 %).
Il s’agit d’une maladie insidieuse, avec des signes cliniques non spécifiques : douleur, tuméfaction locale des parties molles, fracture pathologique. L’atteinte neurologique survient de manière progressive, entraînant une paraplégie dans 25 à 50 % des cas.
L’aspect radiologique n’est pas spécifique. L’IRM permet de mieux définir les lésions osseuses, d’évaluer l’extension intra-canalaire et donc de mieux orienter le geste chirurgical.
En IRM, les vésicules hydatiques, dans leurs formes typiques, apparaissent en hyposignal T1 et en hypersignal T2 [100].
×
![]()
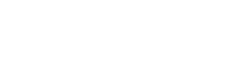
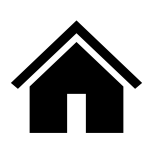 Accueil
Accueil Bibliographie
Bibliographie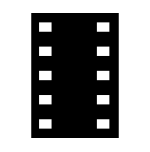 Galerie d'images
Galerie d'images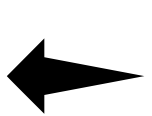 Précédent
Précédent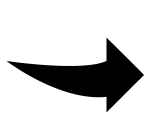 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.