Technique
I) Généralités
L’IRM est la méthode standard pour l’exploration des pathologies médullaires et péri-médullaires. En effet, elle permet une visualisation et une analyse de la moelle sans utilisation de produit de contraste intra-thécal impossible avec toute autre exploration [13].II) Réalisation de l’examen
A) Apports
L’IRM est le gold standard dans l’exploration de la moelle épinière. Elle permet de faire : Le bilan lésionnel précis ainsi que les lésions associées (en particulier du rachis). Le bilan d’extension. Le diagnostic étiologique. L’élimination des diagnostics différentiels.B) Limites
Les principales limites reposent sur le coût (onéreux), l’accessibilité ainsi que sur les contre-indications.Les contre-indications absolues de l’IRM sont [14] :
- Certains pacemakers.
- Certaines valves cardiaques.
- Certains clips vasculaires neuro-chirurgicaux.
- Les corps étrangers métalliques.
De plus, un examen par IRM peut se révéler difficile de par la petite taille des structures étudiées, ainsi qu’à l’existence de nombreux artefacts de flux et de mouvement.
Ces artefacts sont gênants surtout au niveau de la moelle thoracique, et ceci, en raison du flux sanguin dans le cœur et les gros vaisseaux.
Au niveau du rachis cervical, il peut exister des artefacts liés aux mouvements de déglutition du patient.
C) Technique
L’IRM médullaire est aujourd’hui majoritairement réalisée avec un aimant supraconducteur haut champ de 1,5 Tesla ou 3 Tesla (dans les centres la possédant) [15].L’IRM 3 Tesla est particulièrement contributive en neuro-radiologie.
En effet, elle permet d’obtenir 2 fois plus de signal que les appareils réguliers de 1,5 Tesla. Il en résulte des images de meilleure qualité, des coupes plus fines, une meilleure résolution, ainsi qu’un temps d’acquisition réduit [16].
Cependant, son accessibilité est encore plus limitée que les modèles à 1,5 Tesla.
L’antenne :
Pour l’étude de la moelle spinal et du rachis, on utilise une antenne rachis en réseau phasé.Les antennes rachis comportent trois ou quatre bobinages étagés. Ces bobinages sont disposés le long des vertèbres cervicales, dorsales et lombaires [17].
Chaque élément d'antenne possède son propre canal de réception du signal et produit l'image de la région anatomique en regard de laquelle elle se trouve.
Les différentes images sont ensuite combinées par des algorithmes informatiques pour former l'image terminale.
Ce principe apporte un très haut signal/bruit et permet un large champ d'exploration (jusqu’à 48 cm) [18].
La position :
- Patient en décubitus dorsal.
- Vérification méticuleuse de l’alignement du rachis dans le plan sagittal.
- Le centrage sera fait au milieu de la zone à étudier : région cervicale, thoracique ou lombaire [19].
III) Séquences et coupes utilisées
Les séquences IRM les plus importantes pour l’étude de la moelle spinale sont les imageries pondérées T1, T2, STIR, T2* et T1 après injection (avec saturation de graisse) [10].La moelle spinale s’explore [21] :
- Avec le rachis.
- Sur au moins 2 plans de coupes : sagittal et axial.
- Sur 2 champs de vue avec petits champs : 28-32 cm.
- Sur 2-3 mm d’épaisseur de coupe sans espacement.
- Avec au moins 2 pondérations (T1 et T2).
- Avec 2 fois la même séquence T1 avant et après injection de Gadolinium.
A) Séquences de repérage
Il s’agit de séquences en écho de gradient très rapides, permettant de positionner les coupes.B) Coupes sagittales pondérées en T1
Figure 12
Elles correspondent aux coupes de base et, permettent une visualisation de l’ensemble de la moelle, ainsi qu’une bonne étude des corps vertébraux et des disques inter-vertébraux.
La séquence sagittale T1 est la séquence de référence avant injection [22].
Elle permet surtout d’étudier les modifications de signal des espaces péri-médullaires, à savoir : la graisse épidurale, la moelle osseuse.
C) Coupes sagittales pondérées en T2
Figure 13
,Figure 14
,Figure 15
Actuellement, on utilise des séquences en écho de spin rapide (fast spin echo, FSE ou turbo spin echo, TSE en fonction des constructeurs) qui permettent d’obtenir des coupes fines avec un excellent rapport signal/bruit et, peu d’artefacts.
À noter que le principal inconvénient des séquences en écho de spin concerne le temps d’acquisition. Inconvénient qui tend, aujourd’hui, à être réduit grâce au FSE/TSE.
Récemment, certaines machines permettent l’acquisition de séquences de FSE/TSE volumique. Cela permet par conséquent d’obtenir des coupes sagittales extrêmement fines, qui peuvent ensuite être analysées dans les 3 plans de l’espace en post-traitement.
La séquence sagittale T2 permet la détection d’anomalies de signal et de localiser la ou les anomalies [23].
Elle permet ainsi de déterminer si les anomalies sont intra ou extra-médullaire et, leur niveau : cervicales, dorsales ou au cône terminal.
Elle permet aussi d’étudier l’extension en hauteur : > ou < 2 vertèbres.
D) Coupes sagittales T2 STIR
Figure 16
Cette séquence fait partie des séquences pondérées T2.
La séquence STIR correspond à short TI (inversion time) inversion recovery.
Elle permet une suppression non sélective du signal de la graisse grâce à la technique d’inversion-récupération.
Attention, à ne pas confondre avec les séquences de saturation de la graisse (FATSAT).
Cette séquence permet une diminution de la pondération T2 et une augmentation du contraste lésion / moelle [24].
Elle est très utilisée pour démontrer la présence de lésions tumorales, d'une contusion osseuse, de fractures dans le squelette.
Elle est aussi réputée plus sensible dans l’identification des lésions intra-médullaires, y compris les œdèmes médullaires.
E) Coupes axiales pondérées en T1 et T2
Figure 17
,Figure 18
Ce type de coupes peut être utilisé pour étudier la moelle ou les racines.
Pour l’étude de la moelle, il vaut mieux pratiquer des coupes assez épaisses (6 à 7mm) afin d’augmenter le rapport contraste/bruit.
Par contre, l’étude des racines demande la réalisation de coupes fines (2 à 3mm).
L’étude des racines en séquence axiale pondérée en T1 est intéressante surtout à l’étage lombaire où le contenu du canal de conjugaison est principalement graisseux.
L’étude des racines et des disques se fait au mieux en inclinant les coupes dans le plan de chaque disque à l’aide d’acquisitions multi-angles, multi-coupes.
F) Coupes en T2*
Figure 19
Ce type de séquence permet d’obtenir un effet myélographique sur des coupes axiales. Elle permet également une bonne visualisation des disques.
Cette séquence permet aussi la recherche de produit de dégradation de l’hémoglobine et mettre ainsi en évidence des remaniements hémorragiques.
Ces séquences peuvent également être utilisées en mode d’acquisition 3D et on obtient ainsi une pile de coupes très fines qui peuvent ensuite être reformatées dans n’importe quel plan de l’espace.
G) Coupes avec injection de produit de contraste paramagnétique (Gadolinium)
Figure 20
,Figure 21
En pathologie médullaire, intra-durale extra-médullaire ou extra-durale, l’injection de produit de contraste (PDC) paramagnétique, le Gadolinium, est fondamentale.
Le Gadolinium est administré par voie veineuse à la dose de 0,1 mmol/kg.
Elle permet de mettre en évidence certaines lésions et de mieux analyser les lésions intra- médullaires.
Les séquences injectées se font en T1 avec ou sans saturation de graisses (FATSAT) dans les 3 plans.
Les coupes axiales et sagittales T1 sont généralement les plus utilisées.
L’injection permet de visualiser :
- La confirmation de la prise de contraste médullaire.
- La localisation au niveau de la substance blanche et/ou grise.
- La prise de contraste sous arachnoïdienne.
Les séquences injectées avec FATSAT seront principalement utilisées dans le cadre de lésions extra-médullaires.
Tandis que pour les lésions intra-médullaires, on utilisera des séquences injectées sans FATSAT.
×
![]()
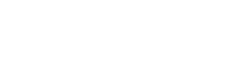
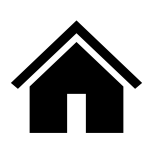 Accueil
Accueil Bibliographie
Bibliographie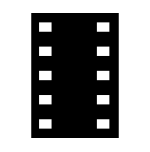 Galerie d'images
Galerie d'images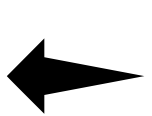 Précédent
Précédent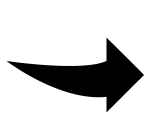 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.