La moelle épinière constitue la partie caudale du système nerveux central.
Elle est contenue dans le canal rachidien, en occupant la partie qui s’étend de la 2ème vertèbre cervicale (C2) à la 2ème vertèbre lombaire (L2).
Elle représente le lieu de passage des principales voies de conduction nerveuse. Elle est à l'origine de tous les nerfs rachidiens qui sont au nombre de 31 paires.
La connaissance parfaite de son anatomie permet l’interprétation correcte des examens paracliniques, en particulier l’IRM.
Elle présente une forme cylindrique, légèrement aplatie d’avant en arrière.
Enfin, entre le sillon médial dorsal et les sillons collatéraux dorsaux se trouve les cordons dorsaux.
Ces derniers sont parcourus d'un sillon intermédiaire, uniquement au niveau de la moelle cervicale. Ce sillon divise le cordon postérieur en 2 faisceaux [3] :
Une coupe transversale de la moelle spinale dévoile une substance grise profonde en forme de H formée de corps cellulaires de neurones, et une substance blanche périphérique composée d'axones myélinisés.
Au centre de la moelle épinière, se trouve un canal central appelé canal épendymaire, qui occupe toute la hauteur de la moelle sur la ligne médiane et qui se continue en haut par le 4ème ventricule.
La substance grise est plus volumineuse au niveau des renflements (ou intumescences) cervical et lombaire [4].
Les 2 cordons ventraux, situés en dedans des cornes ventrales, unis entre-eux par la commissure blanche antérieure. Ce cordon est parcouru par plusieurs faisceaux :
Ce cordon est parcouru par des faisceaux sensitifs : les faisceaux gracile (ou de Goll) et cunéiforme (ou de Burdach) [4].
À la sortie du trou de conjugaison, chaque nerf rachidien se divise en :
Son diamètre transversal de 10 à 12 mm ; nettement inférieur à celui du canal rachidien qui se situe en moyenne dans la marge de 14 à 22mm. La moelle n’occupe que le 2/3 du canal.
En avant, on retrouve les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Latéralement, les pédicules délimitent les trous de conjugaison vers lesquels se dirigent les racines antérieures et postérieures des nerfs spinaux (ou rachidiens).
En arrière, on retrouve les ligaments jaunes, les lames vertébrales et les apophyses épineuses.
Les racines dorsales sensitives émergentes du sillon collatéral dorsal. Ces dernières portent chacune le renflement d’un ganglion spinal.
Les méninges sont les structures entourant la moelle épinière, à savoir : la dure-mère, l’arachnoïde et la pie-mère.
La dure mère forme à la moelle une enveloppe qui s’étend du trou occipital à S2 où elle se termine en cône. La surface extérieure de la dure mère est séparée du rachis par l’espace épidural que remplissent des plexus veineux et de la graisse.
L’arachnoïde et la pie mère délimitent l’espace sous arachnoïdien dans lequel se trouve le LCR (liquide céphalo rachidien).
Dans cet espace, entre les racines ventrales et dorsales sont tendus les ligaments dentelés ; leur bord interne est continu et fixé à la pie mère, tandis que leur bord externe est fixé a l’arachnoïde.
L’espace arachnoïdien représente un vaste réservoir du LCR. En dessous de la moelle (entre L2 et S2) l’espace n’est occupé que par les nerfs de la queue de cheval [3].
Les sources de la vascularisation artérielle sont multiples et la vascularisation veineuse est fondée sur un riche système de plexus.
Les vaisseaux vascularisant la moelle sont de petite taille et possèdent une réserve d'allongement permettant d'adapter le système vasculaire aux mouvements du rachis.
La vascularisation de la moelle spinale n'est pas homogène sur toute sa hauteur. Ainsi, le segment thoracique moyen pauvrement vascularisé est particulièrement sensible à l'ischémie.
Les axes spinaux dorsaux sont postéro-latéraux, placés en regard des sillons collatéraux dorsaux.
Les axes verticaux sont bien développés au niveau cervical mais sont ensuite plus discontinus, en particulier au niveau du segment thoracique moyen, sensible aux modifications hémodynamiques.
Ces axes forment un plexus artériel péri-spinal plus dense dans la partie ventrale. Les artères radiculo-spinales pénètrent la dure-mère pour suivre le nerf spinal et se diviser en artères radiculo-spinales ventrales et dorsales.
Au contact de la moelle, les artères radiculo-spinales se divisent chacune en deux branches, formant ainsi à chaque étage un cercle vasculaire péri-médullaire.
L'artère radiculo-spinale la plus importante est l'artère d’Adamkiewicz, située dans la partie thoracique inférieure et la partie lombaire supérieure. Ce vaisseau contribue significativement à la vascularisation de la partie inférieure de la moelle spinale [7].
Entre l'axe artériel spinal ventral et les axes spinaux artériels dorsaux se constitue un réseau artériel pie-mérien, circulaire, parfois qualifié de plexus coronaire.
L'axe artériel spinal ventral donne naissance aux artères sulco-commissurales qui pénètrent dans la fissure médiane. Celles-ci vascularisent la corne ventrale, la corne latérale et la base de la corne dorsale de la substance grise ainsi que les faisceaux cortico-spinal et spino-thalamique.
Les axes artériels spinaux dorsaux donnent naissance à des branches artérielles perforantes qui vascularisent les faisceaux graciles et cunéiformes.
Le plexus pie-mérien périphérique fournit également des branches qui pénètrent les parties latérales de la moelle et vascularisent en particulier, les faisceaux spino-cérébelleux.
Ainsi se trouvent constitués les trois territoires artériels majeurs de vascularisation intra-parenchymateuse : les territoires spinal ventral, spinal dorsal et périphérique.
Le drainage veineux est calqué sur la disposition artérielle.
Les veines sulco-commissurales drainent le sang veineux de la partie ventrale de la moelle spinale de manière bilatérale vers l'axe veineux spinal ventral et les veines radiculaires [7].
Les veines intra-spinales dorsales drainent le sang de la partie dorsale de la moelle vers l'axe veineux dorsal médian.
Les veines intrinsèques périphériques se jettent dans le réseau veineux péri-spinal, pour rejoindre enfin la circulation générale comme suit :
Une topographie anatomique et fonctionnelle de cette substance peut être établie [8].
Les neurones effecteurs se rassemblent en 2 groupes de noyaux :
La substance blanche est le lieu de passage de grands faisceaux ascendants ou descendants, appelés voies longues, qui relient la moelle aux centres supra-segmentaires.
Le faisceau radiculaire interne pénètre dans le cordon dorsal, remonte vers le bulbe et constitue les faisceaux graciles et cunéiformes [9].
Il existe 2 grandes voies : la voie de la motricité volontaire et celle de la motricité automatique [10].
Le faisceau cortico-spinal est né de cellules pyramidales du cortex cérébral
Cette voie traverse le centre ovale, la capsule interne, le mésencéphale, le pont, le bulbe et la partie inférieure va s’entrecroiser et aller vers le coté opposé [11].
Dans la moelle, elle est représentée par 2 faisceaux :
Ces faisceaux sont aussi appelés voies extra-pyramidales, et viennent de différentes régions:
Toutes les structures anatomiques dépendant de ce segment spinal font partie du métamère.
On trouve ainsi :
La notion de dermatomes est fondamentale car on peut tester la sensibilité des dermatomes et ainsi, faire un diagnostic lésionnel d’une atteinte de la moelle épinière ou du rachis. (Exemple : une atteinte de T4 entrainera une paresthésie et/ou anesthésie des territoires innervés par les dermatomes en dessous de cette vertèbre).
Elle est contenue dans le canal rachidien, en occupant la partie qui s’étend de la 2ème vertèbre cervicale (C2) à la 2ème vertèbre lombaire (L2).
Elle représente le lieu de passage des principales voies de conduction nerveuse. Elle est à l'origine de tous les nerfs rachidiens qui sont au nombre de 31 paires.
La connaissance parfaite de son anatomie permet l’interprétation correcte des examens paracliniques, en particulier l’IRM.
I) Anatomie descriptive
La moelle épinière est un cordon blanchâtre, de 40 à 50 cm de longueur, 9 à 13 mm de diamètre et pèse 30 g.Elle présente une forme cylindrique, légèrement aplatie d’avant en arrière.
A) Division topographique
On distingue 5 parties à la moelle [1] (
Figure 1
) :- Le segment supérieur, court de 2 cm, faisant suite au collet du bulbe, s’étend jusqu’à C3.
- Le renflement (ou intumescence) cervical, mesurant 10-12 cm, s’étend de C3 à D2 et, correspond à l’origine des branches du plexus brachial.
- Le segment dorsal, long de 20 cm, s’étend de D2 à D9 et donne naissance aux nerfs intercostaux.
- Le renflement (ou intumescence) lombaire, mesurant 10 cm, s’étend de D9 à L1 et donne naissance aux nerfs destinés aux membres inférieurs.
- Le cône terminal, se termine en regard du bord supérieur de L2. Il est entouré par les racines nerveuses et forme la queue de cheval.
B) Configuration externe
La surface de la moelle est parcourue par des sillons longitudinaux qui délimitent des cordons au niveau de la substance blanche [2] (
Figure 2
) :- Le sillon médian antérieur, aussi appelé fissure médiane, est profond et, parcourt toute la longue de la moelle.
- Les 2 sillons collatéraux ventraux, se situant de part et d’autre du sillon médian antérieur, correspondent à l’émergence des racines ventrales des nerfs spinaux (ou rachidiens).
- Les 2 sillons collatéraux dorsaux correspondent à l’insertion des racines dorsales des nerfs spinaux (ou rachidiens).
- Le sillon médian dorsal est peu profond et se prolonge en profondeur par le septum médian postérieur.
Enfin, entre le sillon médial dorsal et les sillons collatéraux dorsaux se trouve les cordons dorsaux.
Ces derniers sont parcourus d'un sillon intermédiaire, uniquement au niveau de la moelle cervicale. Ce sillon divise le cordon postérieur en 2 faisceaux [3] :
- L’un médial : faisceau gracile (ou de Goll).
- L’autre latéral : faisceau cunéiforme (ou de Burdach).
C) Configuration interne (
Figure 3
)Au centre de la moelle épinière, se trouve un canal central appelé canal épendymaire, qui occupe toute la hauteur de la moelle sur la ligne médiane et qui se continue en haut par le 4ème ventricule.
1) Substance grise
La substance grise correspond aux centres nerveux médullaires et présente :- Deux cornes ventrales ou antérieures, volumineuses et trapues à extrémité irrégulière, contenant les corps cellulaires des neurones moteurs.
- Deux cornes dorsales ou postérieures, étroites et effilées, contenant les corps cellulaires des neurones sensitifs. Elles sont classiquement décrites comme possédant un col et une tête.
À l'extrémité de la tête se place la zone marginale (de Waldeyer).
Entre la tête de la corne dorsale et la surface spinale s'intercale la zone terminale (de Lissauer) formée par des fibres qui pénètrent la moelle.
La substance grise est plus volumineuse au niveau des renflements (ou intumescences) cervical et lombaire [4].
2) Substance blanche
La substance blanche contient les faisceaux des principales voies longues du SNC. Elle est subdivisée en 3 cordons : ventral, latéral, dorsal.Les 2 cordons ventraux, situés en dedans des cornes ventrales, unis entre-eux par la commissure blanche antérieure. Ce cordon est parcouru par plusieurs faisceaux :
- Moteurs correspondant aux faisceaux cortico-spinal ventral, tecto-spinal, réticulo-spinal ventral, vestibulo-spinal.
- Sensitif correspondant au faisceau spino-thalamique ventral.
- Les faisceaux moteurs, situés dans la partie profonde du cordon latéral, dans la concavité des cornes ventrale et dorsale.
Ils comprennent les faisceaux cortico-spinal dorsal, rubro-spinal et réticulo-spinal latéral. - Les faisceaux sensitifs sont plus périphériques et comprennent les faisceaux spino-cérébelleux ventral et dorsal ainsi que, le faisceau spino-thalamique dorsal (ou latéral).
Ce cordon est parcouru par des faisceaux sensitifs : les faisceaux gracile (ou de Goll) et cunéiforme (ou de Burdach) [4].
D) Racines et nerfs spinaux
Les racines sont au nombre de deux pour chaque nerf rachidien :- La racine ventrale émerge du sillon collatéral ventral, entre le cordon ventral et latéral.
- La racine dorsale, plus volumineuse, émerge du sillon collatéral dorsal, entre le cordon latéral et dorsal. Elle présente à sa partie externe un renflement ; le ganglion spinal.
À la sortie du trou de conjugaison, chaque nerf rachidien se divise en :
- Branche antérieure, volumineuse, qui s’unit aux branches voisines pour former des plexus.
- Branche postérieure, plus grêle.
- 8 cervicales
- 12 dorsales
- 5 lombaires
- 5 sacrées
- 1 coccygienne
Leur direction est variable selon le niveau considéré (
Figure 1
) :- La 1ère paire est légèrement ascendante.
- La 2ème et la 3ème paire sont horizontales.
- Les suivantes sont descendantes au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’extrémité inférieure. En effet, la moelle épinière s’arrête au niveau de L2, si bien que les racines inférieures doivent effectuer un long trajet vertical pour atteindre leurs trous de conjugaison respectifs.
II) Rapports
A) Avec le rachis
La moelle épinière ne remplit le canal rachidien ni en hauteur ni en largeur. Sa longueur est en moyenne de 45cm pour un canal rachidien dont la longueur moyenne est de 70cm.Son diamètre transversal de 10 à 12 mm ; nettement inférieur à celui du canal rachidien qui se situe en moyenne dans la marge de 14 à 22mm. La moelle n’occupe que le 2/3 du canal.
En avant, on retrouve les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Latéralement, les pédicules délimitent les trous de conjugaison vers lesquels se dirigent les racines antérieures et postérieures des nerfs spinaux (ou rachidiens).
En arrière, on retrouve les ligaments jaunes, les lames vertébrales et les apophyses épineuses.
B) Avec les racines
Les racines ventrales motrices émergent du sillon collatéral ventral.Les racines dorsales sensitives émergentes du sillon collatéral dorsal. Ces dernières portent chacune le renflement d’un ganglion spinal.
C) Avec les méninges (
Figure 4
)La dure mère forme à la moelle une enveloppe qui s’étend du trou occipital à S2 où elle se termine en cône. La surface extérieure de la dure mère est séparée du rachis par l’espace épidural que remplissent des plexus veineux et de la graisse.
L’arachnoïde et la pie mère délimitent l’espace sous arachnoïdien dans lequel se trouve le LCR (liquide céphalo rachidien).
Dans cet espace, entre les racines ventrales et dorsales sont tendus les ligaments dentelés ; leur bord interne est continu et fixé à la pie mère, tandis que leur bord externe est fixé a l’arachnoïde.
L’espace arachnoïdien représente un vaste réservoir du LCR. En dessous de la moelle (entre L2 et S2) l’espace n’est occupé que par les nerfs de la queue de cheval [3].
III) Vascularisation
La vascularisation de la moelle spinale est plus complexe et moins systématisée que celle du reste du système nerveux central.Les sources de la vascularisation artérielle sont multiples et la vascularisation veineuse est fondée sur un riche système de plexus.
Les vaisseaux vascularisant la moelle sont de petite taille et possèdent une réserve d'allongement permettant d'adapter le système vasculaire aux mouvements du rachis.
La vascularisation de la moelle spinale n'est pas homogène sur toute sa hauteur. Ainsi, le segment thoracique moyen pauvrement vascularisé est particulièrement sensible à l'ischémie.
A) Vascularisation artérielle
La vascularisation artérielle de la moelle spinale est organisée autour d'un système vertical et d'un système horizontal, issus tous deux des branches de l'arc aortique et des branches segmentaires thoraciques et lombaires de l'aorte [6] (
Figure 5
).1) Axes artériels verticaux
Le système vertical est formé par trois axes : l’axe spinal ventral et les deux axes spinaux dorsaux. L'axe artériel ventral est un axe médian situé en regard du sillon ventral médian.Les axes spinaux dorsaux sont postéro-latéraux, placés en regard des sillons collatéraux dorsaux.
Les axes verticaux sont bien développés au niveau cervical mais sont ensuite plus discontinus, en particulier au niveau du segment thoracique moyen, sensible aux modifications hémodynamiques.
Ce système provient des branches spinales, antérieures et postérieures, de l’artère vertébrale (
Figure 5
).2) Artères horizontales
Le système horizontal est formé par les artères radiculo-spinales, issues des artères segmentaires de l’aorte (
Figure 5
).Ces axes forment un plexus artériel péri-spinal plus dense dans la partie ventrale. Les artères radiculo-spinales pénètrent la dure-mère pour suivre le nerf spinal et se diviser en artères radiculo-spinales ventrales et dorsales.
Au contact de la moelle, les artères radiculo-spinales se divisent chacune en deux branches, formant ainsi à chaque étage un cercle vasculaire péri-médullaire.
L'artère radiculo-spinale la plus importante est l'artère d’Adamkiewicz, située dans la partie thoracique inférieure et la partie lombaire supérieure. Ce vaisseau contribue significativement à la vascularisation de la partie inférieure de la moelle spinale [7].
3) Vascularisation intra-spinale (
Figure 6
)L'axe artériel spinal ventral donne naissance aux artères sulco-commissurales qui pénètrent dans la fissure médiane. Celles-ci vascularisent la corne ventrale, la corne latérale et la base de la corne dorsale de la substance grise ainsi que les faisceaux cortico-spinal et spino-thalamique.
Les axes artériels spinaux dorsaux donnent naissance à des branches artérielles perforantes qui vascularisent les faisceaux graciles et cunéiformes.
Le plexus pie-mérien périphérique fournit également des branches qui pénètrent les parties latérales de la moelle et vascularisent en particulier, les faisceaux spino-cérébelleux.
Ainsi se trouvent constitués les trois territoires artériels majeurs de vascularisation intra-parenchymateuse : les territoires spinal ventral, spinal dorsal et périphérique.
B) Vascularisation veineuse (
Figure 6
)Les veines sulco-commissurales drainent le sang veineux de la partie ventrale de la moelle spinale de manière bilatérale vers l'axe veineux spinal ventral et les veines radiculaires [7].
Les veines intra-spinales dorsales drainent le sang de la partie dorsale de la moelle vers l'axe veineux dorsal médian.
Les veines intrinsèques périphériques se jettent dans le réseau veineux péri-spinal, pour rejoindre enfin la circulation générale comme suit :
- Les veines jugulaires postérieures au niveau cervical.
- Les veines petite et grande azygos au niveau dorsal.
- Les veines lombaires, ilio-lombaires, sacrées latérales et sacrées moyennes au niveau lombaire.
IV) Systématisation
A) Substance grise
Beaucoup de cellules sont disséminées. Certaines se regroupent en amas qui ont, l’aspect de noyaux sur des coupes horizontales, et l’aspect de colonnes sur des coupes longitudinales.Une topographie anatomique et fonctionnelle de cette substance peut être établie [8].
1) Zone somato-motrice
La zone somato-motrice, située au niveau de la tête des cornes ventrales, représente le centre de la motricité volontaire des muscles striés.Les neurones effecteurs se rassemblent en 2 groupes de noyaux :
- Médian ou antéro-interne innerve les muscles axiaux.
- Latéral ou antéro-externe innerve les muscles pariétaux (thoracique et abdominal) et des membres.
2) Zone somato-sensitive
La zone somato-sensitive est divisée en deux parties :- Les noyaux de la tête de la corne dorsale sont constitués par les deutoneurones de la sensibilité extéroceptive (tactile, thermique et douloureuse).
- Les noyaux de la base de la corne dorsale, correspondant à la colonne de Clarke et Bechterew, représentent les centres où viennent faire relais les fibres du protoneurone de la sensibilité proprioceptive ; cette dernière désigne la perception, consciente ou non, de la position des différentes parties du corps.
3) Zone viscéro-motrice
Elle correspond à la base des cornes ventrales et à la corne latérale. Elle représente le centre de la motricité involontaire qui commande les muscles lisses des viscères, des vaisseaux et des glandes.4) Zone viscéro-sensitive
Elle correspond à la partie postérieure de la zone intermédiaire. C’est le centre de la sensibilité viscérale ou sensibilité intéroceptive.B) Substance blanche
Malgré son aspect macroscopique homogène, les cordons sont constitués d’une mosaïque de faisceaux.La substance blanche est le lieu de passage de grands faisceaux ascendants ou descendants, appelés voies longues, qui relient la moelle aux centres supra-segmentaires.
1) Voies ascendantes ou sensitives
À l’entrée de la moelle, les fibres de la racine dorsale se divisent dans la zone marginale de Lissauer en 2 contingents [2] :- Un contingent externe, ou latéral, fait de fibres de petits calibres qui pénètrent dans la corne dorsale où elles font relais dans le deutoneurone situé dans la tête de la corne dorsale. Ce contingent représente la voie de la sensibilité extéroceptive.
- Un contingent interne, ou médian, fait de fibres de gros calibres qui remontent le cordon dorsal, rejoindre leur deutoneurone situé dans les noyaux graciles et cunéiformes du bulbe. Ce contingent représente la voie de la sensibilité tactile épicritique.
a. Voies extéroceptives
Il existe deux modes de sensibilité extéroceptive :- La sensibilité prothopatique ou nociceptive est transmise par des fibres fines à cheminement lent (Celles-ci font relais dans les cellules de la tête de la corne dorsale et vont croiser la ligne médiane en passant par la commissure grise antérieure et constituer :
Figure 7
).- Le faisceau spino-thalamique antérieur qui conduit la sensibilité tactile grossière.
- Le faisceau spino-thalamique postérieur (ou latéral) qui conduit la sensibilité thermique et douloureuse.
- Ces faisceaux constituent le système extra-lemniscal.
- La sensibilité tactile épicritique plus fine, plus délicate est transmise par des fibres à gaine de myéline, épaisses et à cheminement rapide (Ces fibres ne font pas relai dans la corne dorsale, elles montent dans le cordon dorsal et vont faire relai des les noyaux graciles et cunéiformes.
Figure 8
).
Elles constituent le système lemniscal.
b. Voies proprioceptives
Les voies proprioceptives conscientes transportent les fibres de la sensibilité musculaire, osseuse et articulaire.Le faisceau radiculaire interne pénètre dans le cordon dorsal, remonte vers le bulbe et constitue les faisceaux graciles et cunéiformes [9].
Les voies proprioceptives inconscientes possèdent des deutoneurones représentés par les noyaux de Clarke et Bechterew, à partir de là, 2 faisceaux vont au vermis du cervelet par 2 voies (
Figure 9
):- De la colonne de Clarke, les fibres traversent la base de la corne dorsale et montent dans le faisceau spino-cérébelleux dorsal (ou de Flechsing) homolatéral. Ce faisceau transporte les fibres proprioceptives inconscientes du tronc et des membres inférieurs.
- Du noyau de Bechterew, les fibres croisent la ligne médiane en passant par la commissure grise postérieure et vont constituer le faisceau spino-cérébelleux ventral (ou de Gowers) controlatéral.
Ce faisceau transporte les fibres proprioceptives inconscientes du membre supérieur.
2) Voies descendantes ou motrices
Ces voies émanent de tous les étages de l’encéphale : du cortex cérébral, des noyaux gris centraux.Il existe 2 grandes voies : la voie de la motricité volontaire et celle de la motricité automatique [10].
a. Voie de la motricité volontaire (Figure 10)
Dans la moelle, elle est représentée par 2 faisceaux :
- Le faisceau pyramidal direct, dont les fibres se terminent dans la corne ventrale controlatérale.
Ce faisceau aboutit aux noyaux médians qui commandent les muscles axiaux. - Le faisceau pyramidal croisé est plus important, ses fibres cheminent dans les cellules de la corne ventrale homolatérale.
Ce faisceau aboutit aux noyaux latéraux qui commandent les muscles pariétaux et les muscles des membres.
b. Voie de la motricité automatique
La motricité automatique est transmise par les faisceaux sous cortico-spinaux.Ces faisceaux sont aussi appelés voies extra-pyramidales, et viennent de différentes régions:
- Le diencéphale est à l’origine des fibres diencéphalo-spinales.
- Le mésencéphale est à l’origine du faisceau rubro-spinal.
- Les tubercules quadrijumeaux sont à l’origine du faisceau tecto-spinal.
- Le bulbe est à l’origine des faisceaux olivo-spinal et vestibulo-spinal.
- Le cervelet est à l’origine du faisceau en crochet de Russel.
V) Organisation métamérique
Un métamère représente l’ensemble des structures organisées autour d’un segment de la moelle spinale, lui même défini par l’émergence des racines ventrales et dorsales des nerfs spinaux.Toutes les structures anatomiques dépendant de ce segment spinal font partie du métamère.
On trouve ainsi :
- Un dermatome, correspondant au territoire cutané innervé par les branches sensitives d’un même nerf spinal. (Tous les nerfs spinaux, à l’exception de C1, délimitent des dermatomes.
Figure 11
) - Un myotome, correspondant au territoire musculaire innervé par le même nerf spinal.
- Un sclérotome, correspondant aux os et articulations innervés par le même nerf spinal.
- Un angiotome, correspondant aux vaisseaux innervés par le même nerf spinal.
- Un viscérotome, correspondant aux viscères innervés par le même nerf spinal.
La notion de dermatomes est fondamentale car on peut tester la sensibilité des dermatomes et ainsi, faire un diagnostic lésionnel d’une atteinte de la moelle épinière ou du rachis. (Exemple : une atteinte de T4 entrainera une paresthésie et/ou anesthésie des territoires innervés par les dermatomes en dessous de cette vertèbre).
Les niveaux des principaux dermatomes s’organisent comme suit [12] (
Figure 11
) :- C5 : Clavicule
- C6 : Pouce
- C8 : 4ème et 5ème doigts
- D4 : Mamelon
- D10 : Ombilic
- L2 : Face supéro-médiale de la cuisse
- L3 : Face médiale du genou
- L5 : Dos du pied
- S1 : Face latérale du pied et du 5ème orteil
- S2, S3, S4, S5 : Périnée
×
![]()
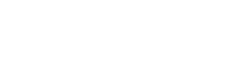
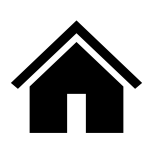 Accueil
Accueil Bibliographie
Bibliographie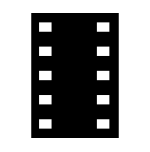 Galerie d'images
Galerie d'images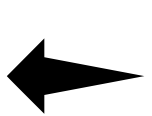 Précédent
Précédent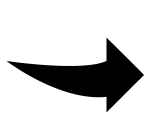 Suivant
Suivant 2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.
2022 © COPYRIGHT AB-IMAGERIE ALL RIGHTS RESERVED.